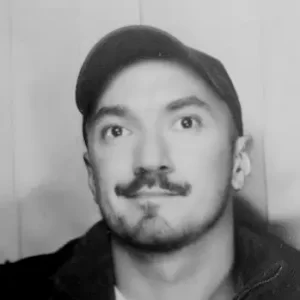13ᵉ Festival du Film de Montreuil : entre cinéma du monde et jeunes voix
Du 24 au 30 septembre, Montreuil vit à l’heure du cinéma avec la 13ᵉ édition de son Festival, installé au Méliès, le plus grand cinéma public d’Art et Essai d’Europe. Une semaine de rencontres et de découvertes, marquée par la présence exceptionnelle de Jafar Panahi, Palme d’or à Cannes, et par une compétition internationale réunissant, entre autres, Dominik Moll, Romane Bohringer ou encore Hafsia Herzi.
Rencontre avec Stéphane Goudet, directeur artistique du festival.
Cette 13ᵉ édition coïncide avec les 10 ans du Méliès. Au-delà de la célébration, qu’avez-vous voulu raconter à travers cette programmation anniversaire ?
Le Méliès est un lieu central à Montreuil : un cinéma public qui défend toutes les formes de cinéma venues du monde entier. Pour moi, c’est un geste politique : rappeler que le cinéma n’est pas seulement un divertissement, mais une manière de penser le monde et de rassembler des publics très différents. Pour marquer cet anniversaire, il nous fallait un invité exceptionnel. Jafar Panahi s’est imposé naturellement : il vient de retrouver sa liberté, il a reçu la Palme d’or à Cannes pour Un Simple Accident et une nomination aux Oscars pour représenter la France. Sa présence est un symbole immense et une chance incroyable pour le festival et pour le public.

Votre sélection réunit Hafsia Herzi, Romane Bohringer, Dominik Moll, Sébastien Betbeder… Comment avez-vous pensé ce dialogue entre des voix déjà reconnues et des écritures émergentes ?
Nous avons un critère fort : la présence de tous les cinéastes en compétition. On veut des auteurs confirmés, mais aussi des découvertes plus risquées. La sélection croise documentaires, fictions, animation, et vient de territoires très variés. C’est ce qui fait sa richesse. Et les spectateurs sont directement impliqués : ils votent pour le Prix du Public, ce qui donne une vraie résonance collective aux choix artistiques.
Vous insistez sur l’idée d’un festival sans hiérarchie entre les genres. Comment cela se traduit-il cette année ?
La diversité, avant tout. Pour nous, il n’y a pas de genre “mineur”. Par exemple, nous avons choisi de mettre Arco d’Ugo Bienvenu dans la compétition générale, et pas seulement en section jeune public. C’est un geste éditorial : rappeler que l’animation est une forme majeure de cinéma. Et puis, après des retours de jurys regrettant l’absence de comédies, nous en avons trois cette année, dont le très bon Baise-en-ville de Martin Jauvat sur la vie en grande banlieue parisienne. L’idée, c’est vraiment d’ouvrir grand les portes et de surprendre avec toutes les formes possibles de cinéma.
Vous parlez de coups de cœur, mais aussi d’exigence éditoriale. Comment conciliez-vous intuition et cohérence dans vos choix ?

Blanche Gardin dans L’incroyable femme des neiges
C’est beaucoup une affaire de rencontres. Le film L’Incroyable femme des neiges de Sébastien Betbeder avec Blanche Gardin, par exemple, je l’ai découvert à Berlin : je leur ai dit tout de suite que si la sortie avait lieu après octobre, je lui gardais une place au festival. Beaucoup de films viennent aussi de Cannes, toutes sections confondues. Mais on aime compléter par des œuvres plus secrètes, sans distributeur parfois, comme L’Œuvre invisible d’Avril Tremboulet, documentaire sur le Don Quichotte inachevé avec Jean Rochefort. Et il y a les avant-premières : L’Étranger de François Ozon, découvert à Venise, fera sa première française à Montreuil. Nous présenterons aussi La Petite Dernière d’Hafsia Herzi, qui a été l’une des grandes révélations cannoises.
Sept films présentés n’ont pas encore de distributeur. Est-ce une mission du festival de donner une première visibilité à ces œuvres fragiles ?
Oui, absolument. Ce sont souvent des films puissants, venus de pays encore peu visibles sur la carte du cinéma. Le festival leur offre une première rencontre avec le public. Et grâce au jury d’étudiants, qui rédige des critiques envoyées aux producteurs, on prolonge leur visibilité et on contribue, modestement, à leur circulation.
Le jeune public occupe aussi une place importante. Pourquoi est-ce essentiel dans un festival international ?
Parce qu’un festival doit aussi refléter le travail d’une salle. Le Méliès a une programmation jeune public très riche, et nous voulons transmettre ce goût du cinéma dès l’enfance. Avec le cycle Circuits courts, nous mettons aussi en avant les courts métrages de l’Est parisien, pour garder un lien fort avec notre territoire et ses spectateurs les plus proches.
Treize ans après la création du festival, comment continuez-vous à le réinventer ?
On ne cherche pas à grossir pour grossir. Mais à rester exigeant et généreux. Aujourd’hui, nos séances de compétition font salle comble, ce qui est un beau signe. Le défi, c’est de maintenir ce niveau et de continuer à donner de la visibilité à toutes nos sections : des courts métrages au jeune public, en passant par les films sans distributeur.